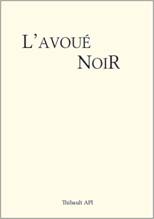|
L’Avoué Noir Recueil
de nouvelles Format
14x20cm à la française Couverture
souple Broché,
234 p. Se faire une idée du livre (texte intégral de la première nouvelle au format .pdf) - Ce
livre n’est pas disponible en librairie - © Thibault Api 2009 |
Mon
souffle intérieur Né
en 1975 à Versailles d’une mère musicienne et d’un père militaire, les
premières années de ma vie se déroulèrent dans un appartement du camp
militaire de Satory. Les chars d’assaut faisaient vibrer les fenêtres de la
salle à manger en bloquant leurs chenilles pour tourner l’angle de l’immeuble
où nous habitions, et moi je les regardais en appuyant le bout de mon nez sur
la vitre, blotti dans les bras de ma mère. Très rapidement, je voulus devenir
pilote de chasse, mais la puberté, quand j’eus treize ans, s’en mêla, en
faisant se révéler la myopie de mon père. Les avions s’envolèrent à tout
jamais sans moi après une visite chez l’ophtalmo et une ordonnance pour une
paire de lunettes que je ne mis jamais durant les quatorze ans que dura ma
scolarité. En
1980, j’eus un frère, Pierre. C’est moi qui lui ai donné son nom. En contrepartie,
quelques trente-trois ans plus tard, c’est lui qui eut l’idée de mon nom
d’écrivain : Api. Thibault Api, voilà comment tu t’appelles quand
t’écris, m’a-t-il dit. Quand je lui demandai pourquoi un nom si court, et si
étrange, il me répondit simplement : parce que t’as l’air heureux, quand
t’écris ! Il me fallut une bonne après-midi de réflexion pour me rendre
compte qu’Api sonnait comme happy, qui veut dire heureux en anglais. Je ne
suis vraiment pas un rapide. Si je suis un être en intelligence avec quelque
chose qui existe, c’est certainement avec la lenteur. Avec un peu de chance,
j’arriverai à être adulte à l’âge auquel d’autres ressentent les effets des
premiers rhumatismes. Pierre,
arrivé à la puberté, tomba myope, comme moi cinq ans plus tôt, ce qui
l’obligea à renoncer à ses rêves de tireur d’élite. Décidemment, notre chère
mère n’avait pas eu un ventre qui voulût bien fabriquer deux bons militaires,
surtout que notre myopie ne venait pas d’elle, mais de notre père. En
classe, j’étais très doué en biologie. Un jour, un professeur de
sciences-naturelles me dit : tu rédiges très bien en bio ! j’espère
que ça te servira plus tard. Je ne savais pas encore dans quel genre de
bourbier allait me mener cette réflexion. C’est bien vrai que les instincts
prémonitoires sont partout ; le plus dur, c’est de les reconnaître.
C’est le présent qui écrit le futur, mais il écrit seul dans son coin, comme
moi. Mes
parents divorcèrent. Je me retrouvais seul avec mon frère et ma mère. Comme
d’habitude, car mon père n’avait été qu’un absent ; simplement, avec ce
divorce, son absence devint officielle, péremptoire et solennelle, pareille à
une chose brusque donnant le réflexe de se protéger le visage du coude en
raison du pouvoir qu’elle eut de transformer certains sujets en coups
possibles à recevoir. En
1995, j’obtins mon baccalauréat en série scientifique en ayant choisi
l’option biologie, très joliment appelée Sciences de la Vie et de la Terre.
Je dis très joliment parce qu’en fait, je trouve ça très laid : Sciences
de la Vie et de la Terre. Ce n’est pas de l’ironie, mais mon côté dualiste
qui ressort à la surface. Le dualisme, je crois être capable d’en parler
parce que je ne suis absolument pas philosophe, mais que je le vis au
quotidien. Le dualisme, c’est le contraire du manichéisme. Le dualiste comme
moi est un esprit qui s’offre le luxe inouï de pouvoir se contredire tout en
restant cohérent. Je dis blanc, je dis noir, mais je parle toujours de la
même chose, et il n’y a que ça qui compte, finalement. Je vous aime et dans
le même temps je ne vous aime pas, mais je tiens à vous, je tiens à vous si
fort que jamais je ne lâcherai – alors dans mes façons de me contredire, vous
apprécierez à la longue l’immense confort de vous sentir en sécurité. Il ne
faut pas oublier que les dualistes sont presque toujours des extrémistes de
bon aloi, c'est-à-dire des âmes fidèles à ce qu’elles ont choisi d’haïr et
d’aimer pour le voir se transmuter. Le Bien change au contact du Mal, et Le
Mal change au contact du Bien, c’est ainsi, personne n’y peut rien ;
nous sommes tous voués dans ce bas monde à ressentir ces étranges phénomènes
d’osmose et de contre-osmose se réguler d’eux-mêmes sur la membrane que notre
peau leur offre pour avoir lieu. Action, réaction ; chute,
ascension ; peu importe, au fond, car tant que persiste le mouvement
perdure la vie. Il
n’y a que dans la chute qu’on se rend bien compte des efforts qu’il y a à
produire pour monter. La chute c’est, en quelque sorte, le mode d’emploi du
succès. L’avenir me dira si je l’ai bien lu. Je n’en suis pas très sûr, car
dans la chute, non seulement on est libre, mais en plus la vitesse est telle
qu’on se retrouve très souvent avec dans les yeux les larmes provoquées par
les souffles d’air froid. Une amie m’a confié un jour que le succès était
aussi simple à mettre en route qu’un aspirateur. Etant donné la qualité de
son parfum, la qualité de son parquet, la qualité de ses tapis d’Orient, la
qualité de son bronzage, et, bien entendu, étant donné la qualité de son
intelligence, je l’ai crue sur parole.
Mon
frère et moi suivîmes notre mère sur le bûcher lorsque, ayant été licenciée
par son employeur pour de sordides raisons, nous nous retrouvâmes avec elle à
la rue, ce qui nous fit gagner les chemins de longues périodes d’errance. Mon
frère et moi nous nous transformâmes donc bien malgré nous en deux Cathares
condamnés à suivre l’hérétique honnêteté de notre mère, ceci afin de ne pas
risquer de mettre en péril la vie de nos âmes, et pour conserver grâce à nos
deux corps autour d’elle le minimum de feu nécessaire à la survie de notre
mère. La rue, faut-il le rappeler, ça tue, c’est une mise à mort, sociale et
morale – un anéantissement qui vous amène jusqu’à la cendre. Je rappelle ça
pour ceux et celles qui n’ont pas connu la rue, mais qui voudraient s’en
souvenir quand même. Je
n’ai jamais voulu me coller dans le lit d’une femme pour obtenir les
certitudes médiocres qu’offrent à l’avenir un congélateur, une télévision et
un bail trois-six-neuf signé avec une compagnie d’HLM. Je suis un rêveur
invétéré, et la seule manière que j’ai trouvée de ne plus avoir honte de ce
terrible défaut tient dans le fait d’écrire, non pas pour moi, mais pour les
autres, bien que je ne me sente pas capable de les amener jusqu’à la
rédemption, tout simplement parce que je n’ai reçu aucune grâce, divine ou
sociale. Est-ce
que j’ai une femme ? Et bien non, un vrai dualiste ne peut pas avoir de
femme, car j’ai bien trop compris ou ça pouvait me mener : à
l’expérience sophistiquée et donc au mensonge. Un vrai dualiste ne peut pas
avoir de femme, ne peut pas avoir de monastère ; il lui reste donc bien
peu d’endroits où s’abriter. Le pire, c’est que je crois vraiment ce que je
dis, car je crois autant au bien qu’au mal. Si vous êtes un visiteur lecteur
philosophe de formation et que vous vous sentez aigri de ce que vous lisez
ici parce que les mots dualisme, manichéisme et autres vous provoquent de la
jalousie, de l’aigreur, car mal employés ou galvaudés au vu de ce que votre
apprentissage vous a dit d’eux, je n’y peux rien. Néanmoins, veuillez trouver
dans le néant émotionnel dans lequel me plonge votre indisposition toutes mes
excuses. Nous vivons une époque où la philosophie va de nouveau appartenir
aux vrais philosophes (ceux qui n’ont aucune formation en philosophie). Je
sens cette ère frémir ; son arrivée sentait très fort dans les courants
d’air de la rue ; bientôt, la philosophie ne pourra que reconnaître les
siens, et là, on va bien rire. Le
bonheur de la vie avec une femme est une issue que ma conscience a bien
malgré moi condamnée. Je suis assez fier de cet éboulement de gros gravas
comblant ce hiatus lorsque je descends en moi-même pour y observer. C’était
Corneille, me semble-t-il, qui disait : « Apprends à te
connaître et descends en toi-même. » Moi, je me suis cassé la figure dès
la troisième marche de l’escalier lorsque j’ai commencé à descendre en
moi-même pour découvrir qui j’étais. Il faut dire qu’on m’a poussé dans le
dos. Le geste de la société à l’égard de celui qui s’interroge est, en effet,
pas toujours très régulier. Je
me suis autoédité, et, croyez-moi, s’autoéditer ne fait pas jouir car être
obligé de se reconnaître soi-même dans l’art que l’on exerce pour tenter son
ultime chance en tant qu’artiste, c’est une sorte de crucifixion, une mise à
nu humiliante et désolante durant laquelle le moindre geste, le moindre
courant d’air souffle sur des braises, et où le cœur bat sourdement,
paraissant gonfler un abandon devenu plus grand à chaque coup nouveau. Je
pense que l’abandon est ce qui caractérise le plus la vie – peut-être, même,
en est-il le synonyme. Si tu te sens abandonné lorsque tu écris, alors ton
écriture est en vie ; voilà ce que je me dis souvent lorsque je me
penche sur mes feuilles. Je
ne suis pas directement croyant en Dieu, mais je crois qu’Il existe d’une
drôle de façon qui me fait me retenir de Le prier – qu’Il existe d’une façon
si drôle qu’elle ne me fait pas rire du tout. La
Croix, c’est, me semble-t-il, à moi qui ne suis pas chrétien, mais un simple
observateur de la chrétienté, c’est, disais-je, le lieu géographique de
l’existence ; quiconque n’a pas été dessus ne peut pas tout à fait
sentir ce qu’est la vie, et donc se ressentir en vie – et Dieu sait qu’il y
en a de multiples formes de la Croix, c'est-à-dire des pièges des déroutes
des déveines, financiers, amoureux, sanitaires, pour vous crocheter aux
mollets et aux poignets et vous enfoncer au plus profond du cœur une vitale
banderille qui vous fera comprendre que vous êtes vous-mêmes l’essence que le
Temps veut voir flamber pour exister. Le
livre, L’Avoué Noir, que vous pouvez voir à gauche de ce texte, je le remets
à vos bons soins. Il est intégralement disponible au format PDF et possible à
acheter également en tant qu’ « objet livre ». J’ai fixé le
prix arbitrairement, après avoir entendu les types dans le couloir de
l’immeuble de la cité où je réside actuellement revendre la barrette de
résine vingt euros. Comme vous le voyez, amis visiteurs, je veux être dans le
coup (dans le coût ?) imposé par l’air du temps. Je fais mon deal, sauf
que chez moi, on peut consommer gratuitement autant de fois qu’on veut ;
je suis un dealer au grand cœur, c'est-à-dire un brave type réfléchissant
trop à son goût qui n’aurait pas fait fortune en tant que revendeur
d’héroïne. Le
livre pèse deux cents quatre-vingt dix grammes hors dédicace (si vous en
voulez une, il vous faudra me la réclamer à deux genoux, ça me donnera
l’impression d’être important), et c’est mes mains à moi et pas celles d’un
autre qui le rangeront dans sa belle enveloppe pour vous l’envoyer. Si le
livre vous a plu et que l’argent vous manque cruellement, ne culpabilisez
pas, il est un peu tard pour être riche, je n’ai plus qu’un ou deux ans de
jeunesse à vivre avant que celle-ci ne soit définitivement partie en fumée !
Comme sur un bûcher ! Et oui, et oui ! A
propos de bûcher, quand j’écris, j’aime bien fumer une cigarette ; je me
sers de sa braise comme un inquisiteur de son tison pour mener à la question
tous mes souvenirs et leur faire avouer tout ce qu’ils ne m’ont pas dit qui
me fait encore souffrir. Le vrai bonheur d’un écrivain consiste à torturer un
souvenir jusqu’à le rendre hybride. Maintenant
qu’on a parlé de bûcher, de fumée et de souvenir on va parler d’essence, et
donc, pour se faire, s’intéresser d’un peu plus près au titre de mon
site : Thibault Api – Ecrivain – qui se trouve à la page d’accueil en
haut dans le ciel au-dessus des oiseaux. Le mot écrivain est entre tirets,
pour la simple et bonne raison que, bien que me sachant pertinemment
écrivain, je suis absolument inconnu et parfaitement ignoré. J’ai mis mon nom
dans le ciel non pas par mégalomanie, mais parce que j’ai toujours rêvé de
voler. Si Dieu existait un seul instant pour moi et qu’Il veuille bien
m’écouter, je Lui demanderais de bien vouloir prendre tout le temps qui me
reste à vivre contre quelques minutes de vol sur le dos d’un oiseau survolant
à tire-d’aile un champ de blé remué par le vent, une forêt d’arbres
d’essences variées et un cours d’eau. Le tiret devant le E de Ecrivain
symbolise le coup de pied que la vie m’a donné au cul, et le tiret derrière
le N de Ecrivain symbolise le coup de poing que je me sens aujourd’hui prêt à
mettre dans la gueule du premier emmerdeur venu qui tâcherait de trop
insister dans son rôle. Comme vous le voyez, amis visiteurs, ma manière
d’être écrivain aujourd’hui est prise entre un coup qu’on m’a flanqué et un
coup que je suis prêt à envoyer. Mon essence est prise dans des tenailles,
dont la mâchoire inférieure est un mauvais souvenir et la mâchoire supérieure
un souhait. Si
vous me lisez, que vous me sollicitez, et qu’un jour, après tout cela, je
sois grâce à vous reconnu, j’enlèverai les deux tirets entre lesquels est
pris le mot écrivain. A ce moment-là, vous pourrez être tous très fiers de
vous, et très sûrs de ma gratitude, en soupirant à pleins poumons comme après
un travail bien fait en vous disant : voilà, nous avons arraché
l’écrivain à ses tirets, nous avons extrait de la bouche de la société une
dent qui la faisait souffrir. Quoi
qu’il en soit, nous ne vivons pas forcément de notre essence profonde. Il y a
des hommes qui mènent des vies de misère, et qui, s’ils pouvaient extraire
d’eux-mêmes leur essence, pourraient la revendre à prix d’or, mais on ne leur
laisse jamais le temps ni les moyens de forer, et ça, ça m’emmène dans de
profondes colères durant lesquelles la nuit est comme une lumière comparée à
la noirceur de ma rage. Je me sens être dans le même cas que ces hommes. Je
mourrai peut-être sans avoir réussi à changer d’état. C’est pour ça que je vous
bouscule. Pour changer soi-même il faut changer les autres. Je me dis
souvent : pour qu’on vous serre la main, il faut bien accepter le risque
de prendre une gifle. Comme
vous pouvez le voir, l’écrivain entre tirets est un autiste volubile. Je suis
une pie étrange qui vole sous la nuit, l’esprit devenu fol à force d’observer
toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel, car je sais très bien que je ne
pourrai jamais en tenir une seule dans mon bec. Après
avoir été tellement idéaliste, j’ai écrit une fois au Très Haut (j’en ai
marre de dire Dieu) une lettre qui disait à peu près ceci : Très Haut
qui nous observe très bien, voici ma requête. Si le phénomène de la
réincarnation existe bel et bien, et que je doive vivre encore une autre vie
pour continuer de me dépouiller de la crasse que la matière apporte à l’âme,
et bien alors fais-moi renaître dans le corps d’un requin blanc, qui lui ne
se sent jamais gêné à l’heure des repas. Signé : Thibault, une âme qui vacille
si violemment parfois qu’elle se sent très fréquemment sur le point de
s’éteindre. Le
pire, c’est que Dieu a répondu, en m’envoyant une lettre dans laquelle Sa
Main Céleste avait écrit ceci : Rassure-toi, petit vivant qui cherche à
devenir grand parmi les tiens, l’âme, c’est comme la flamme d’une bougie
magique allumée sur un gâteau d’anniversaire. Elle crache quand on souffle
dessus et se rallume toujours, si bien que le Malin, quand il joue à ce
jeu-là, finit par retourner en Enfer sans être parvenu à l’éteindre avec la
tête qui lui tourne tant il s’est hyper-ventilé ! Signé : Dieu, qui
ne prend pas soin de toi, parce que tu n’en as pas besoin. Oui,
peut-être, mais moi, j’ai besoin de vous, amis visiteurs lecteurs, sinon,
qu’est-ce que je vais devenir sans vous, hein ; que vais-je devenir sans
vous ? J’ai
un ordinateur et Internet depuis un an et demi environ. Avant, j’étais à la
rue, en train de réfléchir. Bien souvent, quand je regardais l’eau du
caniveau couler, je me disais : voilà de quel genre de bain aurait
besoin toute cette série de riches qui nous oppriment pour faire leur salut.
Si j’ai choqué certains d’entre vous fortunés de naissance, je suis désolé
mais je n’ai pas pu me retenir – je me serais d’ailleurs jugé un être
répugnant si je vous avais dit le contraire. En effet, parfois, je troque mon
dualisme contre du faux-manichéisme histoire de me faire du bien en me
laissant aller à des élans revanchards. En fait, au plus profond de moi-même,
j’aime les riches parce que je les hais, et je hais les pauvres parce que je
les aime. Ce n’est pas compliqué du tout à vivre ; simplement, ça fiche
souvent un sacré tournis ; c’est le tourbillon de la vie, voilà ! Ça y
est, je suis en train de dériver par rapport à ce que je voulais vous dire de
« concret » sur ma vie, mais ce n’est pas grave, je continue, car
c’est toujours dans le flux de la digression que nagent les plus beaux
poissons. Dans
la vie, il y a l’expérience vraie qui mène à la philosophie (qu’on le veuille
ou non) et donc à la vérité, et il y a l’expérience élaborée qui mène à la
sophistication et donc au mensonge. L’expérience vraie est une expérience qui
ne réclame aucun argent pour être vécue, et l’expérience élaborée une
expérience qui nécessite de l’argent pour être connue. Etant donné ma
situation, je suis condamné à l’expérience vraie, c'est-à-dire à ne pas
mettre entre moi et la vie le filtre que procure l’argent. Quand je me
promène en forêt, je respire l’air pur et le pet du lapin qu’il y a dedans.
Mes poumons attrapent toute l’existence d’un bloc. Si le lièvre a vraiment
pété très fort, je me dis : il n’y a plus qu’à courir vite, maintenant,
pour bien vite me retrouver à un endroit moins maudit ! Je
vous disais que cela fait un an et demi que je possède un ordinateur et une
connexion Internet ; cela m’a beaucoup aidé à résister à la tentation de
la rue. En effet, à peine étais-je arrivé chez moi que j’avais déjà envie de
repartir. J’avais trop chaud, à l’intérieur, et tout était très énervant,
exaspérant. Un grand nombre de fois, des gens me dirent : toi qui aimes
écrire, pourquoi est-ce que tu ne racontes pas ton histoire, elle intéressera
sans doute, car elle n’est pas commune ! Je sais qu’ils avaient raison,
mais je n’ai jamais pu, par crainte, par pudeur, et surtout horrifié à l’idée
de mettre ma misère sur le trottoir pour lui faire faire le tapin. Pourtant,
je sais qu’il y a de très grands écrivains qui ont su faire ça, de vendre le
ventre de leur misère à prix d’or. Victor Hugo n’écrivait-il pas, dans Les
Misérables : « Se sauver par ce qui vous a perdu, c’est là le chef
d’œuvre des hommes forts. » Il y a certainement l’habileté du proxénète,
chez le grand écrivain. Si je veux vraiment y arriver, il va donc falloir que
je m’entraîne à être un salaud. Je pense pour cela écrire un roman d’amour. A
propos d’amour, le plus doux souvenir que j’ai d’un flirt fut celui d’un soir
avec la folie – elle m’a à peine embrassé mais depuis, je ne rêve plus que
d’elle, c'est-à-dire de me retrouver avec moi-même et de n’avoir plus à
bouger. Ça ne sera pas ici, ça sera loin, si vous m’ôtez mes tirets. Si je
réussis, on ne sera responsable de rien, vous serez chacun le responsable de
tout. En effet, je crois dur comme fer que l’artiste qui réussit est celui
qui par flair plus que par calcul parvient à coller une identité sur
l’anonymat. En attendant, je suis toujours un renard herbivore. Bon,
maintenant que j’ai bien pleurniché, on va accélérer un peu, histoire de
conclure (sic) ce texte à fleur de surface faisant office de biographie. Tandis
que mon corps souffrait dans la rue et que mon esprit s’était reculé dans les
hauteurs vertigineuses de ma tour d’ivoire, pour toiser le tout et ramener la
douleur jusqu’à rien, mon frère Pierre fit de brillantes études de Japonais.
Pour ma mère, Pierre est l’Est, là où le soleil se lève, tandis que moi je
suis l’Ouest, là où le soleil se couche. Nous avons Pierre et moi cinq ans
d’écart. Je ne savais pas que les deux extrémités d’une journée sur Terre
étaient à une distance de cinq années l’une de l’autre. Je suppose que dans
d’autres familles, les journées sont plus courtes, et dans d’autres encore,
sont plus longues, suivant la différence d’âge et de succès qu’il y a entre
les enfants. Avant
tout cela, j’ai fait de la guitare, du violon ; à force d’exercer ma
main, mon esprit s’entraîna sans que je m’en rende compte (son exercice était
une sorte de rêve ne s’arrêtant plus), et quand il devint fort, ce fut la
catastrophe, car il se retrouva si puissant qu’il n’y eut nul endroit où mes
mains purent s’accrocher pour le retenir : j’avais pensé. La vibration
de la musique m’avait à mon insu transporté, ramené à mon origine : le
rêve brisé dont nous sortons tous. Forcément, les morceaux de cette flasque
sont très tranchants. Voilà pourquoi quand comme moi on commet l’imprudence
d’en ramasser un bout, on coupe court un peu à tout. J’ai
vécu à Satory, à Angers, au Havre, à Châtenay-Malabry, à Vauvert, à
Bouzigues, à Villeneuve d’Ascq, à Randonnai, et actuellement, je vis à
Compiègne. J’aimerais retourner vivre dans l’Orne où les forêts sont
magiques, les crépuscules incroyables et les journées de ramassage de
champignons l’automne venu absolument fabuleuses. C’est dans l’Ouest, l’Orne,
c’est un coin qui me va bien. Si un jour je vis à Megève, j’espère
franchement avoir assez de lecteurs et parmi eux un lecteur qui aura assez de
courage pour venir me buter à domicile, parce que là, ça voudrait vraiment
dire que j’ai baissé. Aujourd’hui,
dans la cité, ce fut comme hier et ce fut comme ce sera demain : les
bruits, les cris, les motos en délire et les odeurs de diesel mêlées à celles
des poubelles y furent chez eux. Une cité, c’est un endroit à vivre qui porte
à la fois chance et malheur. Je me dis ça quand je me penche sur la cour des
miracles sous ma fenêtre pour tenter d’imaginer le mien. Car la porte de
sortie, moi qui ai été à la rue, je peux vous le promettre, elle n’est pas
dehors ! |